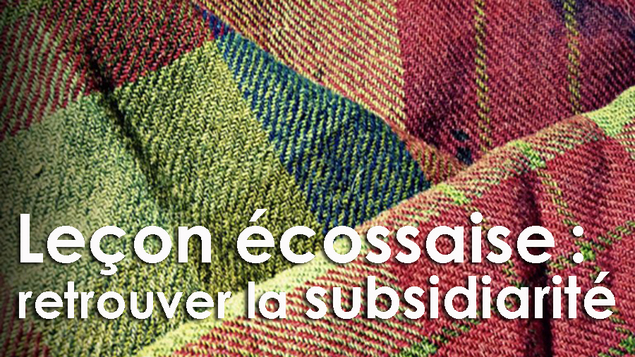
Une politique sans principe échoue toujours. C’est la leçon principale qu’il faut tirer du referendum par lequel les habitants de l’Écosse ont failli, la semaine dernière, décider de détacher leur pays de l’Angleterre.
LE PRINCIPE qui était en jeu, c’était celui de la subsidiarité. Liberté Politique a consacré d’utiles réflexions à sa définition. Sa bonne application est au cœur d’importantes questions politiques, sociales et économiques de notre temps.
Examinons ce qui s’est passé en Écosse. Le referendum du 18 septembre montre que près de la moitié de la population aspire à recouvrer une souveraineté nationale délaissée il y a plus de trois cents ans.
Vue de Londres ou de Paris, la prétention de ces électeurs est absurde. Le courant de l’histoire pousse, nous dit-on, à l’effacement des frontières, aux sociétés multiculturelles, aux abandons de souveraineté. L’avenir appartient aux ensembles politiques et économiques vastes et puissants. Une fraction d’Écossais rêve d’aller en sens contraire.
L’opinion commune, exprimée notamment dans nos grands médias, dénonce ce qu’elle appelle une crispation identitaire et la range dans la même catégorie que les « populismes » français, suédois ou autrichien. Ce sursaut irrationnel serait, là comme ailleurs, porté par les groupes sociaux qui se croient menacés par la mondialisation : les frileux, les passéistes et les détenteurs d’avantages acquis.
Une aspiration de la jeunesse
Cette thèse est démentie par les faits. En Écosse, les partisans les plus fervents de l’indépendance ne se trouvent pas dans les générations âgées ; ils se recrutent dans la jeunesse. On ne les trouve pas dans les cantons les plus ruraux ni dans les modes de vie les plus traditionnels ; ils habitent les banlieues ouvrières. Ils n’exercent guère des activités à l’abri de la concurrence ; ils forment au contraire la majorité des salariés du secteur privé. Bref, ils respirent à pleins poumons l’air de la mondialisation et du multiculturalisme.
Alors comment expliquer un vote aussi étrange ? En reprenant l’histoire des trois dernières décennies. Jusque vers 1985, l’indépendance écossaise ne faisait vibrer que deux ou trois groupuscules sans aucune audience populaire. Tout a changé avec Margaret Thatcher. Sa politique brutale de déréglementation, dénationalisation et désyndicalisation a eu des conséquences désastreuses en Écosse.
Les entreprises d’État, qui portaient l’essentiel de l’activité économique, s’effondrèrent. Leurs salariés furent jetés au chômage. Comme, en même temps, elle réduisait les prestations sociales, les ouvriers licenciés se trouvèrent plongés dans la précarité, la marginalité et l’insécurité. De façon plus dure et plus étendue encore que les Anglais, les Écossais furent obligés de vivre dans une société vouée à un individualisme forcené ou de tomber dans les filets de l’assistance administrative. Broyés entre les mécanismes insensibles du marché et de l’État, ils connurent les affres de la disparition de solidarités vivantes et proches.
Une solidarité de proximité
Aucune communauté humaine ne peut subsister sans la sève d’une solidarité active. Le gouvernement de Londres, tout à son ambition de compétitivité mondiale, ne se souciait pas du désarroi écossais. Alors les laissés-pour-compte de Glasgow et de Perth, désespérant des élites indifférentes et hautaines de l’Angleterre, se tournèrent vers les indépendantistes qui leur présentaient un projet de solidarité sociale à la fois neuve, proche et vivante.
Les élections locales montrèrent que leur audience grandissait.
En 1997 le Premier ministre britannique, Tony Blair, se vit obligé d’y accorder de l’attention. Il crut y discerner une vague aspiration à la décentralisation administrative. Il consentit à confier certaines responsabilités de gestion à une assemblée élue. Il déclara que sa décision était guidée par le principe de subsidiarité. « La subsidiarité, s’écria-t-il, est un principe sain : la dévolution de pouvoirs au Parlement écossais nouvellement créé renforcera l’union de la Grande Bretagne et fera disparaître la menace de séparatisme ».
Pour l’Écosse, une subsidiarité non solidaire
Tony Blair avait une connaissance superficielle de ce que subsidiarité veut dire. Il n’avait probablement pas lu la doctrine sociale de l’Église catholique, où ce terme trouve son origine. Sinon, il aurait su que la subsidiarité est inséparable de la solidarité. Chacune est le complément indispensable de l’autre. Si on les traite séparément, elles se déforment en caricatures d’elles-mêmes. La subsidiarité sans solidarité conduit tout droit à l’exacerbation des différences, au particularisme et finalement à l’éclatement des communautés qui la pratiquent. Faute d’accompagner la dévolution de pouvoirs à l’Écosse par des mesures de solidarité nationale, Tony Blair a, bien involontairement, élargi l’audience des indépendantistes.
C’est ainsi que Cameron, successeur de Blair, s’est vu acculé à un référendum sur la séparation de l’Écosse avec l’Angleterre. Aussi aveugle que son prédécesseur, il pensait le gagner sans peine et mettre fin, une fois pour toutes, à une récrimination agaçante. Il a failli le perdre. Pour éviter la défaite, il s’est humilié, trois jours avant le scrutin, à promettre une dévolution de pouvoirs encore plus étendue. Mais il n’imagine pas plus que Blair d’accompagner sa subsidiarité accrue par un effort de solidarité véritable. Il va donc attiser à son tour le séparatisme qu’il croit éteindre.
En France, la solidarité sans la subsidiarité
Les hommes politiques français n’ont pas une meilleure connaissance des principes que leurs collègues anglais. Ils l’ont montré il y a moins de dix ans en prétendant réussir l’inverse, c’est à dire établir une solidarité sans subsidiarité. La doctrine nous dit qu’une telle solidarité tombe inévitablement dans une gestion froide et bureaucratique qui déresponsabilise et humilie les citoyens. Elle ne peut subsister.
Examinons donc ce qui s’est passé. C’était en mai 2005. Les Français étaient appelés à approuver, eux aussi par référendum, une « Constitution de l’Europe » dont le but proclamé était de renforcer la solidarité entre Européens. En réalité la solidarité exaltée par notre classe dirigeante avait, faute de subsidiarité vivante, dégénéré depuis longtemps en tutelle des technocrates de Bruxelles. La partie la plus active, la plus jeune, de la population française en ressentait vivement le caractère pesant voire humiliant. Elle fit basculer le vote vers le « non ».
Aussi stupéfaite et outrée que l’élite anglaise il y a quinze jours, notre classe dirigeante eut moins de prudence. Loin de proposer un compromis comme Cameron, Nicolas Sarkozy se crut habile en contournant la volonté populaire. Mais il ne régla rien sur le fond. Son rafistolage ne chercha même pas à corriger le déséquilibre entre solidarité et subsidiarité dont souffrait la gouvernance européenne.
La vengeance du principe
Le principe négligé se vengea. Pendant les cinq ans qui suivirent, Sarkozy fut harcelé par les problèmes récurrents que lui posèrent la gestion de l’euro, les accords de Schengen et la politique agricole commune. Il finit par succomber sous le poids des mécontentements populaires qui s’étaient accumulés.
Le lien indissoluble entre solidarité et subsidiarité ne peut être ignoré des responsables politiques sans conséquences graves. Nous en aurons peut-être une autre illustration avec le projet de « réforme » des régions et des départements que François Hollande prépare. Mais qui s’en soucie dans la génération sans principes qui nous gouverne ?
Michel Pinton est ancien député européen.
***
- L’agonie de l’Europe...
- Tous contre le FN ou la funeste polarisation id...
- Morts pour la France, le 13 novembre 2015
- L’Union européenne à l’épreuve de son injustice
- Les métastases du conflit syrien en Europe et l...
- Grèce : Schauble a raison
- L’Europe de Jean Monnet est morte
- Le miracle letton à la sauce grecque ?
- Après le oui au « mariage » gay, où va l’Irlande ?
- La face cachée des élections britanniques














